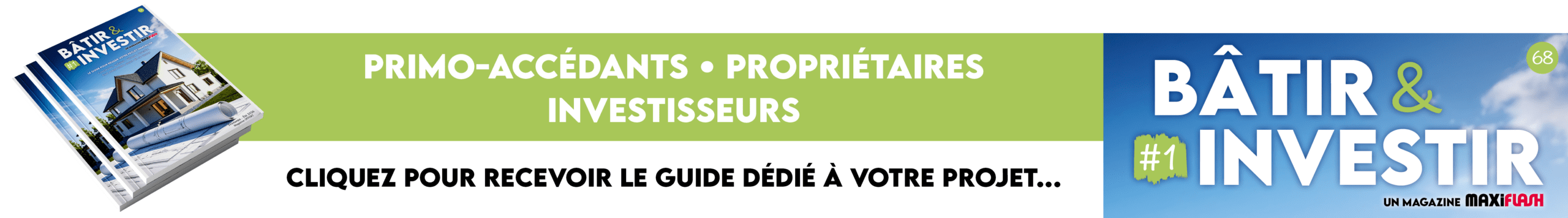Unis depuis plus de cinquante ans, Laurence Winter et Bernard Grandjean forment un couple rare. Rare par la longévité, bien sûr, mais surtout par leur complicité nourrie d’idées, de voyages, de lectures, de convictions… et d’écriture. Car oui, tous deux ont choisi, chacun à leur manière, de faire vibrer leur voix par les mots.
C’est ce point commun — l’écriture comme nécessité intime — qui m’a donné envie de mieux les connaître. Bernard Grandjean fait partie de ces figures que j’ai trop peu croisées, mais dont j’ai souvent entendu parler à la maison. Mon père, lui-même écrivain à ses heures, m’a transmis une admiration discrète pour son travail. Et puis, il y a entre nous ce petit fil invisible, hérité d’Émilie Sieffritt, sa grand-mère… et mon arrière-grand-mère. Peut-être est-ce là que se niche notre lien le plus profond : dans ces racines silencieuses où la langue, la mémoire et l’Alsace s’enlacent.
Deux trajectoires, une même élégance
Leur vie professionnelle aurait pu les mener loin l’un de l’autre. Et pourtant, elle s’est tissée sur une même trame de rigueur et de service. Laurence entre au CIAL en 1972, au sein du groupe CIC. Elle y embrasse une carrière dans la finance puis la communication. Là où d’autres alignent les chiffres, elle cisèle les phrases. « Elle, au moins, elle sait écrire », glissera un collègue, admiratif. Son talent pour la langue, elle ne le doit pas seulement à sa licence d’anglais obtenue en un an au lieu de trois. Elle le cultive avec autant de finesse que de constance grâce à son sens aigu de l’observation et sa passion dévorante pour la lecture.
Bernard, lui, fait son service militaire au 12e régiment d’artillerie à Illkirch-Graffenstaden, avant de rejoindre la Caisse des dépôts à Paris, un poste qu’il intègre un peu par hasard, beaucoup par nécessité. Pas facile, ensuite, de trouver un emploi en Alsace. Mais il y parvient, à force de ténacité, et intègre la Communauté urbaine de Strasbourg, où il navigue entre les services culturels, internationaux, et plus tard les cultes. Une carrière au service du bien commun, marquée notamment par la construction européenne et le rayonnement culturel de la ville.
Une plume en partage
Si leur vie professionnelle est déjà bien remplie, c’est dans l’écriture que se révèle un autre pan de leur histoire commune. Le projet d’écriture de Laurence naît… autour de la table. Littéralement. Lors de dîners mondains, elle écoute, impassible, les discussions qui fusent autour d’elle. Et elle n’en croit pas ses oreilles. Les énormités assénées sur l’Alsace sont sidérantes : la région est perçue comme un Finistère perdu, presque une terre étrangère. Elle ne pipe mot, mais sous la table, quelques coups de pied complices échangés avec Bernard en disent long sur leur ressenti partagé. Discrète, mais tout ouïe, Laurence commence à consigner patiemment les absurdités entendues. Jusqu’au jour où Malou Schneider, la conservatrice du Musée Alsacien, l’encourage vivement à donner vie à cette précieuse et hilarante matière. De fil en aiguille naît un manuel savoureux, à l’ironie tendre, miroir d’une Alsace mal connue, souvent fantasmée, toujours attachante : « Ciel, mon mari est muté en Alsace. » Ce guide, entrée en matière idéale pour les nouveaux venus en Alsace séduit jusqu’à la DRAC et la Région. Avec plus de
50 000 exemplaires vendus, il devient l’ouvrage régional le plus diffusé de France. Une pièce de théâtre est même montée à la Choucrouterie. Un succès aussi inattendu que mérité, fruit d’un regard et d’une plume affûtés.
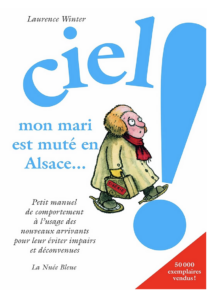
L’écriture comme acte de résistance
Bernard, lui, n’a jamais vraiment cessé d’écrire. À 13 ans déjà, il rédigeait son premier roman. Mais c’est dans les années 80 que l’envie devient nécessité. Lors de plusieurs voyages en Inde, il prend conscience de la lente disparition de la culture tibétaine. « J’étais bouleversé. Je me suis demandé ce que je pouvais faire. Je ne suis pas du genre à manifester… Mais écrire, je peux. »
C’est ainsi qu’il publie Le Jardin des Mensonges, une biographie romancée du SIXIÈME Dalaï-Lama, poète libertaire et amoureux, figure aussi évanescente qu’inspirante. Une manière de faire œuvre de mémoire, et de résistance. Depuis, Bernard a construit une œuvre foisonnante de plus de 35 titres, où la culture asiatique reste un fil rouge, notamment dans ses romans policiers mettant en scène l’intrépide Betty Bloch. Une héroïne libre et décalée, à la croisée de Tintin et de Miss Marple, qui nous entraîne de l’Inde au Tibet en passant par le Népal. L’Affaire du manuscrit tibétain, Le Mystère des cinq stupas, Une vengeance tibétaine ou Le Médecin de Lhassa… Portée par une écriture fluide et documentée, chaque enquête transporte le lecteur dans une Asie riche de traditions, de paysages et d’intrigues savamment menées. Ces romans ont même conquis le public italien, grâce à la maison d’édition spécialiste de L’’Asie qui en a entrepris la traduction des aventures de Betty Bloch. C’est d’ailleurs en Italie que Bernard a peut-être reçu la reconnaissance la plus manifeste pour son œuvre. A sa grande surprise, le Corriere della Sera, pendant transalpin du Monde, lui a consacré un article. Une distinction précieuse au vu du prestige de ce journal.
L’élégance du lien
Ce qui frappe chez Laurence et Bernard, au-delà de leurs carrières, de leurs engagements, de leurs plumes, c’est le lien. Ce lien tendre, parfois malicieux, toujours complice, qu’ils entretiennent entre eux, avec les autres, avec leur ville, avec les cultures. Leur couple semble fait d’équilibre, de respect mutuel, de cette sagesse tranquille que donne le temps quand on l’a traversé ensemble. Et puis d’une curiosité intacte, de cette manière rare de s’émerveiller encore. À travers leurs ouvrages, leurs parcours, leurs engagements, Laurence et Bernard nous rappellent qu’il est possible de conjuguer exigence et légèreté, humour et profondeur, fidélité et liberté. Et qu’au fond, une vie partagée à deux peut être le plus beau terrain d’aventure.