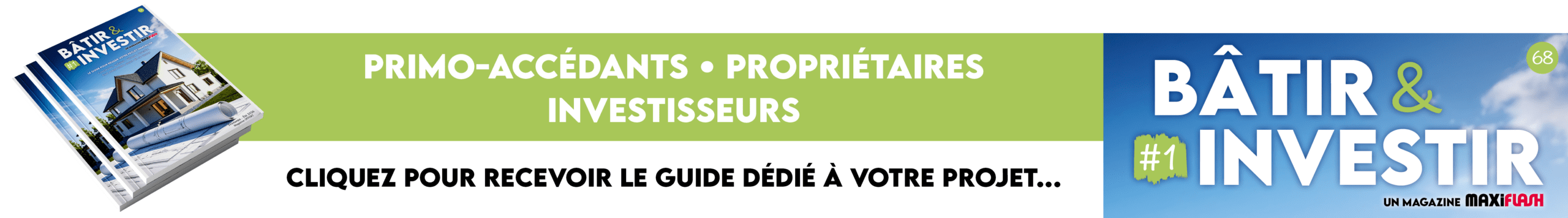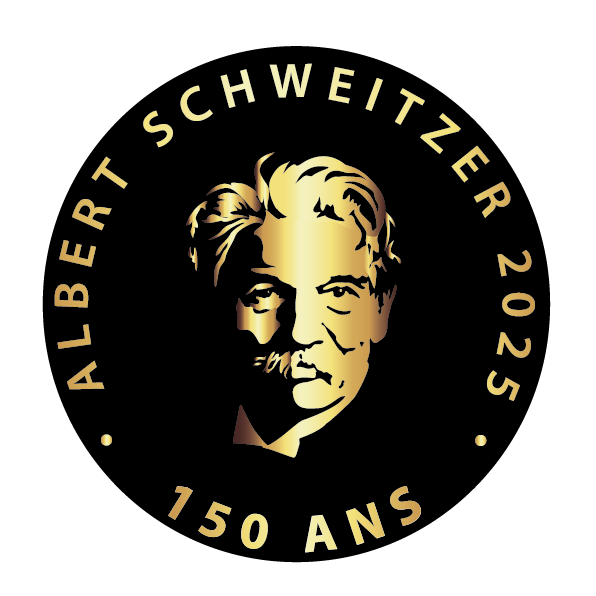Sous surveillance
En 1957 et 1958, Albert Schweitzer intervient quatre fois sur Radio Oslo. Ses prises de paroles, pour dénoncer l’escalade des armements nucléaires, sont reprises par 150 radios dans le monde. Les États-Unis sont agacés. Les services secrets américains orchestrent sa surveillance.
Avant cela, en 1954, il y avait eu le discours de Schweitzer lors de sa réception du Prix Nobel de la Paix. « Les hommes d’État qui ont façonné le monde actuel au cours des négociations consécutives à chacune de ces guerres n’ont pas eu la main heureuse ». Charles de Gaulle, alors président de la République, n’a pas apprécié. D’autant que Schweitzer a enfoncé le clou dans ses ultimes phrases : « Puissent les hommes qui tiennent entre leurs mains le sort des peuples, éviter avec un soin anxieux tout ce qui pourrait empirer la situation dans laquelle nous nous trouvons et la rendre encore plus dangereuse ».
C’est ainsi qu’Albert Schweitzer, jusque-là un mythe adulé dans le monde entier, est devenu la cible des médias et des politiques. Son discours est décrédibilisé. Des rumeurs sont lancées sur son modèle hospitalier et sur sa gestion économique et humaine. Albert Schweitzer a fini par payer au prix fort le fait d’avoir toujours été un homme libre, ne se souciant guère des conventions et des répercussions.
À 11 ans, au lycée de Mulhouse, il s’en était déjà pris à un de ses enseignants en lui reprochant de penser les poèmes au lieu de les ressentir. Plus tard, lors de ses études de théologie, il n’a pas hésité à écrire une nouvelle vie de Jésus puis, pendant ses études de médecine, sa thèse a porté sur l’étude psychiatrique de la vie de Jésus.
En 1915, au milieu de la Première Guerre mondiale, il a écrit : « Le nationalisme consiste en une interprétation pathologique et une transformation de réalités de la vie politique, sur un fond d’idées mégalomaniaques et paranoïaques, produits d’une imagination délirante ». Et voici la suite… 1919, la France a gagné la guerre. L’État français ordonne aux pasteurs, oui leur ordonne, de saluer la victoire française en précisant qu’elle a été voulue par Dieu. Schweitzer refuse. Pire, il affirme devant ses paroissiens que la guerre 14-18 est un échec de l’humanité.
Après cette intervention, il est mis sous surveillance. La police suspecte que ses concerts dans toute l’Europe pour récolter des fonds pour l’hôpital de Lambaréné sont des tournées de propagande pour l’Allemagne. En septembre 1919, un commissaire spécial écrit : « Il y aurait intérêt à surveiller ses agissements pendant ses séjours à l’étranger ». En 1921, il est toujours sous surveillance. Ses déplacements, ses rencontres, la durée de ses rendez-vous à Strasbourg et même à Gunsbach sont notifiés. Cela devait bien faire rire Albert Schweitzer. Il était un homme libre. Libre sans le revendiquer. Libre sans le clamer. Il ne cherchait pas à être rebelle. Il ne cherchait pas à se distinguer. Non. Rien de tout cela. D’abord Albert Schweitzer pensait. Ensuite Albert Schweitzer vivait ce qu’il pensait. Enfin, il disait ce qu’il pensait et ce qu’il disait. Et c’est bien cela qui dérangeait tant.
Francis Guthleben publie dans quelques semaines « Albert Schweitzer intime » aux éditions AISL. L’ouvrage regroupe 100 témoignages sur le Prix Nobel de la Paix recueillis dans le monde entier.
Chronique rédigée par Francis Guthleben