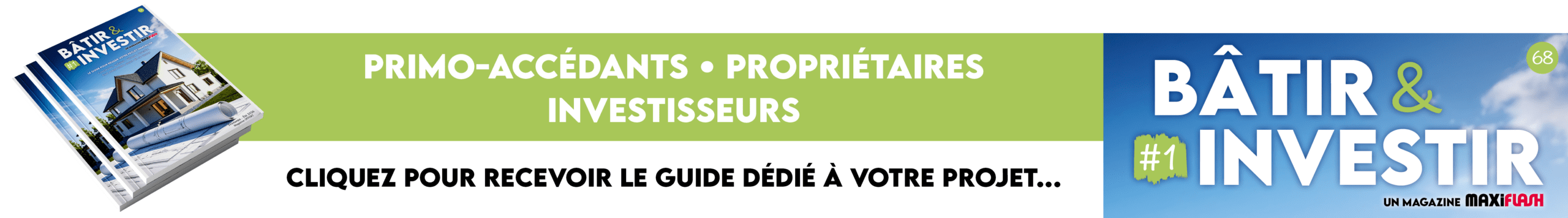Les interrogations
Albert Schweitzer n’a pas échappé à son histoire. Mais avant que son illustre parent Jean-Paul Sartre le théorise, il a appliqué le principe suivant : « L’essentiel n’est pas ce qu’on a fait de moi, mais ce que je fais de ce que l’on a fait de moi ».
Né par sa mère dans une famille de pasteurs, et proche de son père qu’il considérait comme son ami et qui était également pasteur, voici comment tout a commencé. Albert Schweitzer le raconte : « Quand j’ai eu mes 8 ans, mon père me fit cadeau sur ma prière d’un Nouveau Testament dans lequel je me plongeais avec ardeur ». Mais il ne fallait pas compter sur Albert Schweitzer pour devenir un docile lecteur de la bible, gobant les paraboles, les épîtres et les évangiles comme un béni-oui-oui. Jugez plutôt. C’est encore Albert Schweitzer qui parle : « Parmi les histoires qui m’impressionnèrent le plus se trouvait celle des rois mages. Je n’arrivais pas à comprendre pourquoi ils ne s’étaient plus jamais occupés de l’Enfant Jésus. Et je ne comprenais pas pourquoi les bergers ne figuraient pas parmi les disciples du Seigneur ».
Fort déjà de cet esprit critique, Albert Schweitzer rejoint l’Université de Strasbourg en 1893. Il a 18 ans. Il opte pour un double cursus : théologie, comme ses ancêtres, mais aussi philosophie, sans compter des enseignements de musicologie. Schweitzer ne tarde pas à considérer Jésus comme un impétueux prophète annonçant la fin des temps. Il fait aussi grief à certains d’avoir déformé l’image historique de Jésus. Son point de vue est clair : Jésus est plus grand lorsqu’on le laisse être. Il écrit : « Jésus vient à nous, comme un inconnu, sans nous dire son nom, comme sur le rivage du lac vers ces hommes qui ne savaient pas qui il était ». Cela fera l’objet de sa thèse de théologie et d’un ouvrage : « La nouvelle vie de Jésus ». Quel culot ! Plus tard, il dira : « L’Église ressemble à un train de marchandises. Elle avance lentement parce qu’elle a trop de wagons à traîner ».
Schweitzer ne craignait ni de déranger ni d’être critiqué. Beaucoup considèrent que s’il avait continué son chemin à la Faculté de théologie de Strasbourg, il serait devenu un des plus grands, sinon le plus grand théologien de son époque. Et même en arrêtant la théologie protestante pour s’engager à 30 ans dans des études médicales, il n’en avait pas encore terminé avec Jésus. En 1913, sa thèse de doctorat en médecine a pour titre : « L’étude psychiatrique de la vie de Jésus ». Quelques années seulement après la parution des écrits psychanalytiques de Sigmund Freud, il fallait, là encore, oser. Je n’exclus pas un petit penchant pour la provocation de sa part.
Francis Guthleben publie cet automne Albert Schweitzer intime aux éditions AISL. L’ouvrage regroupe 100 témoignages sur le prix Nobel de la Paix recueillis dans le monde entier.
Chronique rédigée par Francis Guthleben