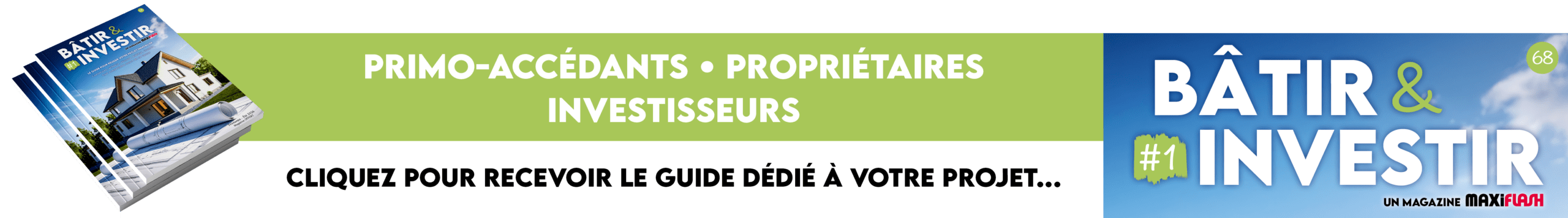Les habitants de Castroville, petite ville de 2500 habitants, située dans le sud du Texas, à 40 kilomètres de San Antonio, sont des descendants d’Alsaciens qui ont abandonné leurs terres au 19e siècle. On découvrait alors que, six générations plus tard, ils continuaient à parler l’alsacien sans jamais avoir mis les pieds en notre région. Des contacts furent noués entre la « grande » et la « petite » Alsace. Des jumelages eurent lieu à partir de 1978 entre Castroville et le village haut-rhinois Niederentzen, comme entre D’Hanis et la commune d’Oberentzen.

Je me suis envolée avec le technicien radio Jean-Marie Rhin, d’Altorf (qui sera nommé en 1990 responsable technique de la radio). Lui s’y était déjà rendu précédemment pour faire connaissance avec de lointains cousins. J’avais pour mission de ramener deux heures d’émissions en alsacien pour la soirée dialectale du jeudi soir (de gross Elsässerowe) ainsi qu’une vingtaine de reportages pour alimenter mes émissions quotidiennes que j’animais le matin entre 9h et 10h en duo avec Ric Alban. La radio et la télé régionales ne faisaient alors qu’une famille, nommée FR3 Alsace, située place de Bordeaux à Strasbourg. Nous étions loin de l’ère numérique. Jean-Marie Rhin portait à l’épaule le magnétophone Nagra, qui pesait, avec le matériel d’enregistrement, une vingtaine de kilos.

Bien que les formalités douanières fussent en règle, nous avons vécu le parcours du combattant pour entrer le magnétophone sur le territoire américain. À Dallas, nous ne sommes pas sortis de l’aéroport, mais les températures extérieures indiquaient 30° Celsius à l’ombre. Une erreur, me disais-je, ils doivent confondre avec le système Fahrenheit. À notre envol d’Entzheim, il avait fait exceptionnellement froid pour un mois d’avril : -6°C.
Il nous fallait rallier San Antonio. Nous volions pour cette dernière étape dans un petit coucou, de nuit, sous un violent orage qui nous infligeait des trous d’air tels que je suis arrivée blafarde à l’atterrissage. Johnny Rihn, le cousin texan de Jean-Marie, nous attendait. Il était deux heures du matin. Il faisait une moiteur tropicale. Johnny m’a conduite chez mon hôtesse, Mable Hiesser, une octogénaire exquise. Elle vivait à l’écart dans une petite maison coloniale remplie de plantes vertes et entourée de verdure.

En avril, la teinte verte avait encore un peu droit de cité au Texas. Dans les champs fleurissaient de petits lupins sauvages de couleurs bleus, appelés blue bonnets. La chaleur naissante commençait à assécher la végétation. L’herbe était haute et il ne fallait s’y aventurer qu’en bottes, car elle bruissait de serpents à sonnette, également nommés crotales (rattle snakes en anglais) dont la morsure est mortelle. Les Texans ont toujours sur eux des piqûres d’antidote. Ils cuisinent la chair des crotales. Découpée en petits cubes, assaisonnée d’herbes aromatiques et de piments puis frite, elle est appréciée à l’apéritif. J’en ai mangé chez Clinton Bourquin, grand fermier texan, qui parlait merveilleusement l’alsacien alors qu’il n’avait jamais posé les pieds sur la terre que ses ancêtres avaient quittée six générations plus tôt.
J’ai vécu une semaine très intense, à faire reportage sur reportage, à peu dormir, à assimiler, tard le soir, la technique du macramé que Mable et ses sœurs voulaient à tout prix m’apprendre. J’essayais d’imaginer les ancêtres de ces Texans, partis d’Alsace, poussés par la famine, posant sur une charrette tirée par un bœuf leurs maigres effets et traversant la France pour arriver au Havre, y attendre l’improbable traversée, puis être reclus pendant des mois sur Ellis Island, dans le port de New York, le temps d’obtenir des papiers et de pouvoir aller vers les terres promises par Henri Castro, des terres certes concédées, mais qui avaient été volées aux Indiens, qui revenaient la nuit pour tuer bon nombre de ces immigrés.

Cent cinquante ans après la venue de leurs ancêtres sur ces terres, je regardais ces Texans de descendance alsacienne. Ils avaient totalement intégré le way of life, la manière de vivre, de là-bas. Ils étaient devenus de vrais cow-boys, souvent grands fermiers, éleveurs de bétail, lestes pour les rodéos et le lancer de lasso auquel ils tentèrent de m’initier. Et ils parlaient une langue apprise de leurs ancêtres avant même la langue anglaise qu’ils n’avaient découverte qu’en entrant à l’école. Leur façon de parler alsacien était teintée d’accent américain. Ils avaient introduit par automatisme des mots anglais. Pour « beaucoup », ils ne disaient pas « viel », mais utilisaient le mot anglais « plenty ». Ils regrettaient aussi, comme nous dans la « grande Alsace », que leurs enfants parlent de moins en moins l’alsacien, car un nivellement inévitable s’opérait.

De mon voyage au Texas, j’ai rapporté la queue d’un serpent à sonnette qui sonne comme une crécelle. Je l’ai toujours et la considère comme un porte-bonheur. J’ai gardé de ce voyage une passion pour rencontrer les Alsaciens où que je sois dans le monde, généralement pour écrire sur eux, comme je l’ai fait pour les DNA, ou pour le magazine Saisons d’Alsace ou comme je le ferai vingt ans après, dans l’Ouest américain cette fois, pour le livre Un été en Californie (La Nuée Bleue, 2000) qui narre le destin de cinquante Alsaciens vivant entre San Francisco et San Diego.