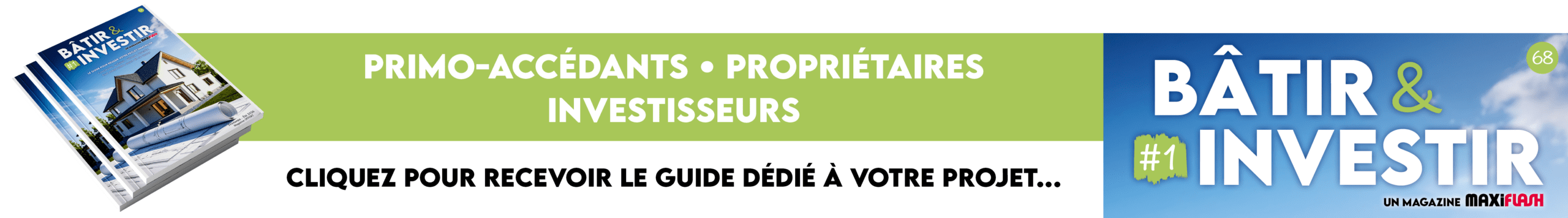Comment un petit-fils de constructeur automobile devient-il éditeur de gravures ?
Les automobiles Bucciali, c’est un peu la légende familiale. Les derniers exemplaires qui restent sont dans de grandes collections américaines. J’ai mis du temps à comprendre que j’étais un produit brut de cette famille de mécano-musiciens. Je voulais faire une école d’art, mais mes parents n’étaient pas vraiment d’accord… Je me souviens du jour où j’accompagne mon père pour livrer une voiture dans un grand atelier où on imprimait les gravures de Salvador Dalí. J’entre un peu par désœuvrement, et me voilà plongé dans le monde de Balzac, avec toutes ces vieilles machines… J’avais toujours entendu parler de l’eau-forte, mais là, c’était réel !
En quoi consiste la taille-douce ?
Vous voyez la typographie ? C’est comme de la gravure sur bois, donc de la taille blanche. C’est le relief qui reçoit le noir, et le creux est blanc. La taille-douce, c’est tout le contraire : le creux reçoit le noir. Mais c’est beaucoup plus fin. On va creuser 2 à 3 millimètres pour une gravure sur bois et deux dixièmes de millimètres pour la taille-douce.

C’est un processus qui demande beaucoup de rigueur…
Oh que oui ! On passe d’abord l’encre sur une matrice puis on l’essuie avec un chiffon très particulier pour garder les blancs blanc et les noirs noir. On pose ensuite une plaque de métal par-dessus et on passe le tout sous une machine avec de l’eau. L’image est ainsi imprimée sur du papier mouillé qu’il faut laisser sécher.
Et si on veut ajouter de la couleur ?
Il faut reporter la première matrice sur une vierge. Il y a jusqu’à trois passages couleur et sept teintes de pression par centimètre carré. Si on fait 6 sujets multipliés par 3 matrices ça fait 18 en rotation avec les couleurs… faut pas se mélanger les pinceaux (rires) !
« j’aime toujours laisser de la fantaisie, un peu d’espace pour ce
qui n’est pas écrit.
En musique, on appelle ça le rubato. »
En 1977, vous ouvrez votre premier atelier à Paris.
Oui, au pied du Centre Pompidou. Rue Rambuteau oblige, je me suis fait des amitiés dans la musique. J’ai assisté à des répétitions de Pierre Boulez, qui a eu une influence considérable sur ma réflexion. C’était quelqu’un de très rigoureux. Il travaillait beaucoup la technique avec ses musiciens. Il m’a appris que l’on trouve toujours son compte dans la préparation, et non l’approximation.
Devenir éditeur de gravures, c’était une évidence ?
Pas vraiment. Quand j’ai ouvert mon atelier à Colmar en 1983, je n’étais pas éditeur, mais j’ai vite compris qu’il fallait que j’exprime quelque chose dans le processus créatif. Comme si j’étais l’interprète d’une partition. Ça m’a permis d’être maître de mes choix esthétiques et de choisir les artistes avec lesquels j’avais envie de travailler.
Comme Raymond-Emile Waydelich…
Tout à fait. Sa disparition a été le plus grand cataclysme de cet été… C’était un ami, un papa, un compagnon de route. On a fait nos premières gravures ensemble pour la Biennale de Mulhouse en 1984, où il a reçu le premier prix. Les dernières doivent remonter à 2022. C’était un artiste remarquable. Le seul Alsacien à exposer à la Biennale de Venise en 1978. En 1995, il a même obtenu les autorisations pour faire un trou sous la cathédrale de Strasbourg ! J’ai d’ailleurs mis des œuvres dans son « caveau du futur ». C’était un grand moment.

40 ans de collaboration, ça représente combien d’œuvres ?
Peut-être 300 ? Je me souviens de notre rencontre à l’atelier, où il essaye la technique de la pointe sèche. « Ça accroche, ça ne me plaît pas » qu’il disait… Le midi, on déjeune dans un restaurant asiatique. Il me montre les baguettes chinoises et me demande « on ne peut pas faire de la gravure avec ça ? ». Ça m’a travaillé toute la nuit ! Le lendemain, je fabrique un vernis spécial. Raymond dessine dedans avec la baguette… Et ça marche !
Avec quels autres artistes avez-vous travaillé ?
Alain Clément, un puits de science sur l’histoire de l’art ! Certaines de ses œuvres sont entrées au Centre Pompidou. Une consécration ! L’une de mes séances les plus fortes, c’était avec Max Kaminski en 1988. On a passé trois jours d’ivresse mentale. Quand on n’a pas encore travaillé avec quelqu’un, c’est comme une rencontre amoureuse. Il faut apprendre à se connaître… Et s’il se passe quelque chose, on tente de s’engager !
Ça fait quoi d’être le dernier graveur éditeur en taille-douce de France ?
J’ai toujours comparé mon aventure à celle des petites maisons d’édition, comme de Minuit ou Actes Sud. Elles ont démarré avec quelques manuscrits, mais les produisaient toujours par conviction. Quand j’ai commencé, il y avait une cinquantaine d’ateliers taille-douce en France. Mais sur les 15 dernières années, j’étais le seul éditeur de gravures contemporaines. Il faut dire qu’apprendre un métier d’art c’est long, plus long que des études de médecine ! On doit être à la fois cultivé, intelligent, curieux et bon dans son approche manuelle.
Ce sont les qualités de votre fille Alma, qui vous a rejoint à l’atelier ?
Complètement ! Alma est une excellente professionnelle et une artiste formidable. Elle a travaillé avec moi pendant 6 ans. Contre 28 pour Mitsuo Shiraishi, mon collaborateur. Il est encore plus précis et rigoureux que je ne peux l’être. Moi, j’aime toujours laisser de la fantaisie, un peu d’espace pour ce qui n’est pas écrit. En musique, on appelle ça le rubato.

Vous avez fermé l’atelier en mai 2024. Où peut-on vous croiser désormais ?
À la foire d’art contemporain ST-ART dont je suis le conseiller artistique. Ce qui va me faire bizarre cette année, c’est de ne pas avoir de stand. La fermeture de l’atelier a été une étape douloureuse, mais je ne veux retenir que le positif, les rencontres avec mes compagnons de route. Je vais continuer de cultiver mon côté artistique à travers la musique, l’écriture, la sculpture… Car après tout, nous sommes d’éternels apprenants !