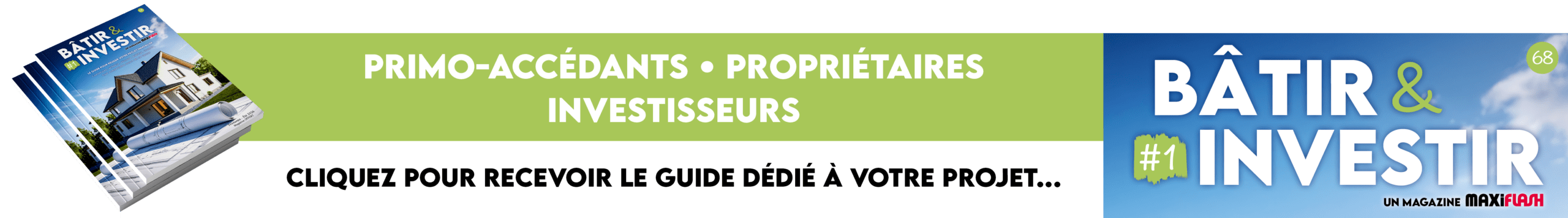Simone Morgenthaler : Comment ce livre a-t-il germé en vous ?
Lydie Bader : L’essai est l’aboutissement d’un long parcours, d’abord inconscient, puis conscient. Nous portons en effet des mémoires individuelles et collectives souvent inaccessibles pendant longtemps et que des événements extérieurs réveillent un jour. Ce moment fut pour moi le point de départ d’une quête : comprendre ce qui s’est passé à Hiroshima qui a alors investi et bouleversé ma vie. Pendant plus de vingt ans, j’ai exploré l’histoire et la culture japonaise, ses relations avec l’Occident et les États-Unis. L’intuition d’avoir été « témoin » de ce qui s’est passé à Hiroshima, d’avoir vécu et vu le désastre absolu vécu par Hiroshima émerge en moi. Que faire de cette mémoire qui me hante ? L’ensevelir à nouveau, ou bien assumer la responsabilité de témoin. L’essai est la réponse.
Pourquoi ce besoin de faire la guerre et de répéter les erreurs ?
L’humanité n’est pas condamnée à faire la guerre ! La culture de la guerre est liée à la dualité conflictuelle qui est le mode de relation de l’ego. La dualité est une matrice d’apprentissage pour l’humanité, sous la forme d’un champ de bataille. Séparer ou unir est l’enjeu de la dualité. Le scénario de la dualité de l’ego se joue aujourd’hui dans les extrêmes où les pôles opposés deviennent des absolus qui opposent une victime et un bourreau, un bon et un méchant. L’humanité est bloquée dans cette polarisation simpliste qui fait l’impasse sur la complexité humaine. Les scénarios belliqueux se répètent tant qu’une recherche élargie des causes du conflit et la conscience d’une responsabilité partagée ne remplacent le règlement de compte où les vainqueurs n’ont jamais de comptes à rendre. L’humanité est prisonnière des conséquences de conflits passés, générateurs de nouveaux conflits. Le but ultime du conflit est l’harmonie après la réconciliation des opposés grâce à la reconnaissance de responsabilités et de torts partagés dans le conflit.
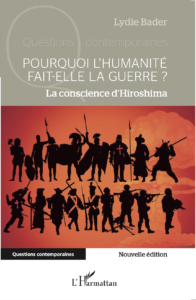
Pourquoi le largage de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki il y a 80 ans vous a-t-il tant marqué ? Avons-nous assez pris la mesure du drame que cela représente ?
Les bombes atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki sont aujourd’hui des faits historiques qui interpellent assez peu la conscience de l’Occident, d’autant que les États-Unis ont imposé un récit officiel insistant sur la nécessité des deux bombes « comme un mal nécessaire » pour mettre un terme à la guerre dans le Pacifique et justifier leurs actes. Ces deux bombes ont instantanément pulvérisé, calciné, grillé, réduit en cendres environ 100 000 personnes à Hiroshima et 70 000 à Nagasaki. On sait aujourd’hui que les deux bombes ont surtout servi les ambitions hégémoniques et géopolitiques des États-Unis face à l’Union soviétique. L’Occident, occupé à se relever après six années de guerre, n’a pas perçu l’extrême gravité de ces deux événements et est resté insensible à ses conséquences, séduit par la puissance de la nouvelle arme vantée par les États-Unis.
Il y a 80 ans, il y avait aussi la libération d’Auschwitz qui a révélé l’horreur du nazisme. Le degré d’inhumanité était aussi puissant que la décision prise par les Américains de détruire Hiroshima et Nagasaki. Peut-on créer un comparatif ?
Effectivement, il y a 80 ans, la découverte des camps de concentration a horrifié l’humanité. « Ce qui s’est passé à Hiroshima » a été poussé aux marges de la connaissance du monde sur injonction américaine. Et pourtant ces deux événements de l’histoire occidentale et orientale forment un binôme où les limites de l’inhumanité ont été franchies et dont les conséquences pèsent encore sur le monde. La bombe atomique a désintégré le garde-fou qui sépare l’humanité de la barbarie. Comme les vainqueurs n’ont jamais eu à rendre compte de leurs débordements, une barbarie normale, normalisée, banalisée, a pu prendre place dans le monde.

Qu’entendez-vous par « la conscience d’Hiroshima » ?
Hiroshima, première ville à voir subi le feu atomique, peut devenir le lieu sacré de la naissance d’une nouvelle conscience, « la conscience d’Hiroshima », qui dénonce la théorie du « mal nécessaire », comme un crime contre l’humanité. L’inhumanité a pu s’infiltrer depuis comme une norme ordinaire inaugurée par les deux bombes atomiques. Le procès de Nuremberg et celui de Tokyo ont jugé et puni la barbarie des vaincus. Celle des vainqueurs n’a jamais été inquiétée. La fission de l’atome à l’origine de la bombe atomique a libéré une énergie de destruction apocalyptique dont l’humanité est incapable d’imaginer la puissance. L’arme la plus destructrice imaginée par des êtres humains, menace encore l’humanité, aux mains d’états dont les dirigeants ont le pouvoir d’en faire usage.
Le livre veut aussi donner de l’espoir aux lecteurs…
Pour moi, l’espoir vient de la société civile au niveau individuel et collectif. Les individus qui œuvrent à apaiser les conflits qui les déchirent, capables de voir leur responsabilité dans leur répétition ouvrent des brèches de lumière, sous forme de relations d’échanges, de dialogues et de partenariat dans un monde saturé de rapports de force, de domination, d’opposition et de violence.
Votre livre va paraître à l’étranger…
Effectivement, les Éditions l’Harmattan-Italia ont choisi l’essai pour une publication en italien. Sa parution est imminente.

Rêvez-vous qu’il soit porté au théâtre ?
Le monologue de Yuki, restée orpheline le 6 août 1945, pourrait devenir un moment théâtral intéressant. À 76 ans, elle témoigne et interroge le sens de ce qui s’est passé à Hiroshima et qui est resté aux marges de la conscience du monde sur injonction américaine. Son destin de survivante l’inspire dans son cheminement vers la conscience et le cœur, à la rencontre de son histoire, de celle de sa mère et de celle d’Hiroshima.