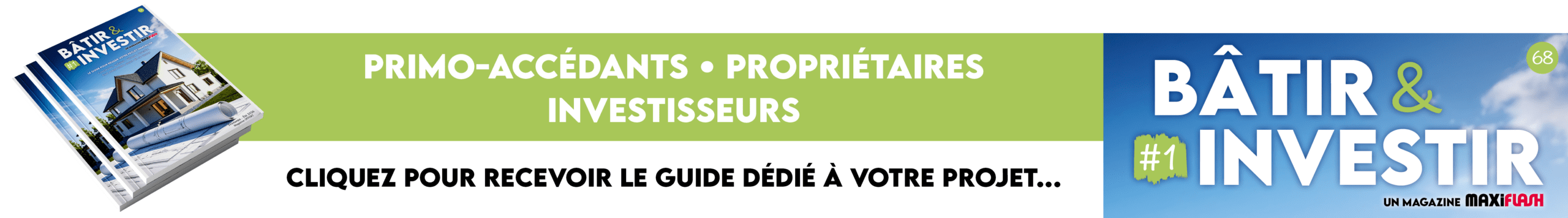Cela fait plus de quarante ans que vous publiez des livres. Comment a démarré cet amour pour l’écriture ?
Ça a commencé il y a cinquante ans même ! En 1975, par un recueil de poèmes en alsacien que j’avais écrit pour moi-même. Un jour on m’a dit que ce serait bien de les publier. Puis j’ai eu la chance de tomber sur un imprimeur qui est devenu un ami. Il a imprimé ce premier recueil. La suite, c’est lié à des occasions propices et des propositions d’éditeurs, sur un sujet précis. Parfois, c’est moi qui vais voir l’éditeur. Il y a un troisième élément : je suis président de la Société d’histoire de la vallée de Munster, qui est elle-même éditrice de certains ouvrages.
Vous avez mené plusieurs vies en une seule. Au-delà de la littérature, de quoi a été faite votre vie ?
J’ai suivi des études de théologie protestante à Strasbourg. Je me suis aussi passionné très vite pour le trésor du patrimoine oral alsacien. J’ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m’ont transmis des comptines, des proverbes, des contes, des légendes. J’ai tout noté. Et j’ai toujours trouvé que ça appartenait à tout le monde. Donc j’ai eu envie de les transmettre. C’est comme ça que progressivement, j’ai été amené à publier des ouvrages sur les légendes, c’est un peu ma spécialité, mais aussi sur les traditions de Noël, de Pâques, des sujets intéressants de la culture régionale. Pour travailler, j’utilise la méthode de l’historien. Afin d’étudier les traditions populaires, je fais une longue enquête sur les sources. Je me définis comme un « historien folkloriste », quelqu’un qui étudie les croyances, les traditions, les légendes, les rites des régions. Je suis aussi le président du festival La vallée des contes de Munster depuis onze ans. J’ai participé à sa création en 1998. On y trouve des conteurs qui viennent de partout, au mois d’octobre. C’est important de parler des croyances et des légendes alsaciennes, pour les connaître et les analyser. Mais le plus important, c’est que je veux être un passeur. Transmettre. Mais je vais avoir 74 ans. Alors l’année prochaine, j’arrête la présidence de la société d’histoire, après quarante-trois ans, et celle du festival. Mais je vais continuer de publier des ouvrages.
« Le plus important,
c’est que je veux être un passeur. Transmettre. »
En parlant de ça, vous avez récemment participé à Mon Schweitzer, un recueil de témoignages sur Albert Schweitzer. Pourquoi ?
Parce que j’ai été sollicité par Francis Guthleben, et que ça m’intéressait. J’ai la chance de l’avoir rencontré à Gunsbach en 1959, j’avais 8 ans. Il ressemblait étrangement à mon grand-père qui venait de décéder, et je ne savais pas si c’était lui ou pas. C’est ce que je raconte dans mon récit. Mais c’est en étudiant à Strasbourg que j’ai vraiment découvert son œuvre et qui il était. C’était un précurseur. On le voit avec son combat contre l’arme atomique, qui est d’une brûlante actualité aujourd’hui, hélas. Et bien sûr, il y a le côté humanitaire, incroyable. Mais, ce qui m’intéresse le plus, c’est son apport sur le plan éthique. Il y a cette responsabilité que nous avons, nous humains, par rapport aux autres êtres vivants, y compris les plantes. Il avait cette attention à toute forme de vie.
Que faut-il retenir de lui ?
Un, la bonté, envers soi et les autres. Deux, ce respect fondamental devant le mystère de la vie, en incluant tout le vivant, pas seulement les humains. À un moment où notre occident est tellement sûr de lui technologiquement et détruit la planète, cette vision est actuelle et extraordinaire. Puis il y a l’absolue cohérence entre la pensée, la foi et l’action. C’est lui qui a dit : « Je crois dans la mesure où j’agis ».